REUSSIR SON PASSAGE DU SECONDAIRE A L’UNIVERSITE : QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
- Cresic Uob
- 5 mai 2023
- 9 min de lecture

’entrée dans l’enseignement supérieur est souvent décrite à la fois comme une nouvelle phase de la vie éducative et comme une transition difficile pour tout individu qui a accès à ce niveau. Les attentes institutionnelles et les finalités des études universitaires assignent aux nouveaux étudiants un rôle différent d’avec la période antérieure. Le choix des études n’est pas sans lien avec la quête identitaire, quête qui tend à occuper une place centrale en définissant le rapport à la société[1].
L’entrée dans l’enseignement supérieur est, à cet égard, un moment privilégié où se développe l’identité de l’étudiant, et ce passage accompagne sa réflexion sur son choix de carrière. Ainsi, être étudiant, c’est se couper du lien d’élève de l’école secondaire et de se vêtir d’une nouvelle identité d’adulte, d’une nouvelle personne ouvert au reste de l’Univers.
Si on la compare à la période du secondaire à celle universitaire, on tend à augmenter considérablement la marge d’autonomie des apprenants en imposant une nouvelle géométrie entre savoir, enseignant et apprenant.
Notre problématique se pose sur la manière de vivre cette transition sans beaucoup de peine d’où notre question de épart :
« Comment réussir cette transition du secondaire à l’université ? »
Pour répondre à cette préoccupation majeure, nous avons posé des hypothèses en rapport à des questions non manifeste qui surgissent autours de notre problème de base :
- la connaissance de soi et la discipline personnelle favoriseraient un passage paisible et réussi du secondaire à l’université
Cette réflexion consiste à offrir au lecteur un outil solide pouvant faciliter ce cheminement du secondaire à l’Université et cela d’une manière réussi.
Compréhension des concepts
Aujourd’hui, tout le monde parle de la réussite, ce terme prend plusieurs connotations selon les domaines de la vie. Du banc d’apprenant au niveau professionnel, tous les efforts sont faits pour permettre de trouver un équilibre vital. Mais au fond, qu’est-ce que c’est? Quels sont les critères qui la définissent ? Comment soutenir un apprenant qui veut poursuivre ses études supérieures ? Nous mettons le cap sur les réponses en cherchant tout d’abord à comprendre les termes comme :

La Réussite
Au sens large la réussite est comprise comme une action, un événement, un travail etc. … réalisé avec succès, excellent, ou remarquable.
Pour le dictionnaire Larousse, Réussir c’est avoir un résultat heureux, se terminer par un succès : ex : Le lancement de la fusée a réussi[2].
Dans les domaines de l’enseignement ou de l’éducation, il existe certainement plusieurs définitions de la réussite, mais pour n’en choisir qu’une, prenons celle du ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur qui pourrait se résumer ainsi : c’est le fait d’atteindre des objectifs précis dans un contexte d’apprentissage. Par exemple : réussir ses examens, acquérir des connaissances dans un délai prévu, passer d’une année à l’autre ou graduer, etc
L’enseignement secondaire et universitaire sont organisés chacun de sa manière en république démocratique du congo.
Enseignement secondaire et Universitaire
Le système éducatif congolais est organisé en deux structures : l’enseignement formel et l’éducation non formelle. L’enseignement formel est dispensé sous forme d’enseignement classique et spécial.[3]
L’enseignement classique est organisé en quatre structures : maternelle, primaire, secondaire, supérieure et universitaire. Le niveau maternel est organisé en cycle unique de trois ans. Le primaire, obligatoire et gratuit, dure six ans. Il est organisé en deux cycles de trois années chacun.
Le niveau secondaire comprend le secondaire général, les humanités générales, les humanités techniques et professionnelles. Le secondaire général est organisé en cycles de deux ans. Les humanités générales s’organisent en deux années de cycle inférieur et deux années de supérieur. Les humanités techniques et professionnelles s’organisent en cycle court et cycle long. La durée de ces deux cycles est de respectivement trois et quatre ans. La formation technique et professionnelle dure quatre ans.
L’enseignement supérieur et universitaire (ESU) congolais comprend deux niveaux. Le niveau supérieur forme les cadres de haut niveau, spécialisés pour l’exercice d’une profession. Le niveau universitaire forme des cadres de conception capables de contribuer à la transformation qualitative de la société[4].
Bien qu’aient été institué le système licence–master–doctorat (LMD), l’ESU fonctionne toujours avec trois cycles (graduat, licence, troisième cycle qui conduit au doctorat). Le graduat dure trois ans, la licence deux ans, comme le troisième cycle (diplôme d’études approfondies). Le doctorat dure entre trois et cinq ans.
L’éducation non formelle vise la récupération et la formation des jeunes et adultes non scolarisés en vue de leur insertion sociale. Elle est assurée dans des établissements spéciaux et centres de formation et se rapporte aux activités de rattrapage scolaire, d’alphabétisation, d’apprentissage, de formation professionnelle et d’éducation permanente[5].
Facteurs

Plusieurs facteurs peuvent favoriser ou défavoriser un passage réussi du secondaire vers l’université. Nous basant sur l’étude d’ENGUTA MWENZI, Jonathan, réalisée en 2020, selon lui Le système éducatif de la République Démocratique du Congo connait des défis énormes,
Au niveau secondaire, le taux d’accès en première année est resté stable depuis 2006, autour de 48 %. On doit s’attendre, avec l’effectivité de la gratuité, à ce que ce taux d’accès puisse augmenter de manière considérable dans les cinq ans à venir.
Le pourcentage des élèves scolarisés dans le privé, qui avait plus que doublé au cours de la décennie 2010, passant de 11,2 % à 24,2 % en 2012, diminuera dans les cinq ans à venir à cause du déplacement des élèves du secteur privé vers le secteur public à la suite de la gratuité. Les proportions d’enfants en âge d’aller au secondaire premier cycle non scolarisés sont inférieures à celles du primaire.
Pour ce qui est du second cycle secondaire, les effectifs se sont accrus de 47 % entre 2006 et 2012. À l’intérieur de ce cycle, les accroissements les plus importants ont été enregistrés, dans le secondaire général et normal, respectivement de 55 % et 52 %. En ce qui concerne l’examen d’État (équivalent du baccalauréat français), secondaire, la conclusion n’est pas la même lorsqu’on examine la qualité de ses réussites. Ngub’usim, Enguta et Kakenza en 2017 ont examiné la qualité des réussites à l’examen d’État 2013 et ont constaté que 14 % d’élèves avaient obtenu leur diplôme avec moins 60 % de points, 25 % avec des points situés entre 55 et 59 % et 61 % avec moins de 55 %. [6]
Le système universitaire congolais, connaît depuis le début de la décennie 2010 une croissance du nombre d’établissements et d’étudiants. Les effectifs ont plus que doublé entre 2006 et 2012, passant de 239 914 à 512 322, et sont inégalement répartis entre les provinces : Kinshasa enregistre 33,5 %, suivie du grand Katanga avec 22,8 % et de la province du Maniema qui occupe la dernière position avec 1,5 % d’effectifs.[7]
Cette même étude montre que : « La répartition des étudiants par niveau montre que plus du tiers des effectifs sont inscrits en classes de recrutement et que seulement 17 % sont en classes terminales. Les taux d’abandon et de redoublement sont très importants, particulièrement dans les classes de recrutement »[8].
L’ESU connaît plusieurs contraintes : l’inadéquation formation-emploi ; la faible qualité de l’enseignement ; la non-viabilité de plusieurs établissements ; le grand besoin en enseignants qualifiés. De telles analyses révèlent une faible mobilisation des compétences visées à ce niveau. Ainsi, le secondaire second cycle souffre de la défaillance du système d’orientation, d’une faible efficience interne ainsi que de mauvaises conditions d’accueil et d’enseignement.
« Les bonnes bases font des châteaux durables » dit-on. Des études précédentes nous avons, nous pouvons déduire que ce passage mérite une attention particulière pour contourner certaines difficultés qui causeraient m’échec de ce processus. Certains facteurs favoriseraient la réussite de ce passage, c’est entre autre[9] :
Facteurs qui favorisent
Les facteurs qui favorisent la réussite de ce passage sont plus liés à des prouvables de connaissance de soi et de discipline personnelle. Nous pouvons citer entre autre :
Ce changement assez radical demande un temps d’adaptation : il s’agit de repenser sa méthode de travail, de réfléchir à ses ambitions et ses objectifs de façon à favoriser la réussite. En Belgique, nombreux sont les étudiants, surtout à l’Université, à gaspiller du temps en première année. Mauvais choix d’orientation, manque d’implication, difficultés à s’adapter à un nouveau système… Mal préparés, beaucoup d’élèves échouent ou abandonnent. De nombreuses études ont tenté d’identifier les facteurs de réussite ou d’échec à l’université. Plusieurs critères reviennent souvent :
1. Le choix des études et les motivations
Plusieurs facteurs interviennent quand il s’agit de choisir une filière d’étude. Quels sont les points forts de l’étudiant, quelles sont ses faiblesses ? Combien de temps l’étudiant est-il prêt à accorder à ses études ? A quel point est-il prêt à s’investir ? Toutes ces questions rentrent en ligne de compte. Le plus souvent, les étudiants choisissent une filière par intérêt intellectuel. Certains ont déjà une idée de métier en tête et vont choisir les études qui débouchent sur une profession particulière.
Une recherche a démontré que les étudiants ayant un projet professionnel très déterminé ne réussissent pas systématiquement mieux que ceux qui entament des études par curiosité intellectuelle. Avoir un projet très fixe et clair n’est donc pas gage de réussite : les étudiants dans ce cas sont au contraire parfois découragés par les cours généraux dispensés à l’université qui peuvent sembler très abstraits en comparaison avec la profession qu’ils désirent exercer. Ils ressentent souvent un décalage entre le contenu de la formation et les objectifs professionnels qu’ils poursuivent. L’intérêt intellectuel reste la motivation la plus déterminante pour la réussite universitaire. Etudier ce qui nous passionne, ça compte !
2. La méthode de travail
Les élèves du secondaire ont l’habitude d’être très encadrés, et de nombreux devoirs sont demandés tous les jours pour ne pas perdre le rythme. A l’université, chacun est livré à lui-même : c’est la responsabilité de l’étudiant d’aller en cours, d’étudier ses syllabus, d’écrire ses synthèses. L’étudiant n’est jamais rappelé à l’ordre, si ce n’est que par lui-même. Il s’agit donc de gagner en indépendance et d’être scrupuleux. Le manque d’organisation et une mauvaise méthode de travail sont les premières causes d’échecs en première année. Le premier blocus ainsi que les premiers examens sont souvent un coup de massue – heureusement, l’étudiant prend conscience de sa situation, et, souvent, parvient à sauver les pots cassés en août, en repensant sa méthode de travail.
3. Le cercle social
Les relations entre étudiants à l’université ne sont pas les mêmes qu’en secondaire. Grands auditoires, centaines de visages, cette marée humaine peut être impressionnante. Se créer un réseau est cependant extrêmement important et l’intégration est également un facteur de réussite. Se faire des amis et être socialement intégré permet de favoriser l’épanouissement. Il est important de savoir demander de l’aide et d’offrir son aide aux autres, de créer des groupes de travail, de partager des notes pour s’assurer que les supports d’études sont complets. Les études sont une étape importante pour créer des relations, avoir un cercle d’amis, et tisser des amitiés qui seront indispensables pour le futur (personnellement et parfois professionnellement parlant.
4. Le milieu social de l’étudiant et le logement
Selon les chercheurs, les étudiants satisfaits de leur logement ont plus de chance de réussir leur première année d’étude, ce qui est relativement logique étant donné le travail à domicile que nécessitent les études universitaires. Pour beaucoup d’étudiants, le commencement de la vie universitaire correspond également au début de la vie en kot. Vivre en collocation, se détacher des parents, gérer un budget, ce nouveau mode de vie se construit en même temps que les semaines et les cours défilent.
Les étudiants dont les parents ont eux-mêmes fait des études supérieures réussissent également plus facilement tout simplement car ils se sentent plus soutenus et mieux compris.
5. Un bon équilibre entre fête et travail
Le Bleusaille, baptême,… Ces traditions font partie intégrante de l’identité de l’université et sont une manière de baigner intégralement dans la vie estudiantine. Nombreux sont les étudiants qui se laissent tenter… et qui sont parfois aspirés dans le tourbillon de la fête. Il est important de trouver un bon équilibre entre les soirées et les révisions. Si certains n’y parviennent pas, d’autres font preuve d’assez de discipline pour gérer les deux. Il n’y a pas de généralités.
Il est cependant important de retenir que toutes les recherches du monde ne pourront jamais prédire la réussite ou la non-réussite d’un étudiant. Milieu social, passé scolaire,… Ces critères restent très généraux. Si les motivations et le choix d’études est bien entendu déterminant, chacun, avec un peu de volonté, de flexibilité et d’organisation peut bien entendu réussir brillamment à l’université. Tout est une question de détermination… et surtout d’envie.
Exigences
Réussir, c’est aussi une question de perception. En plus des attentes formulées par l’école, l’apprenant peut établir seul ses propres critères de réussite universitaire. Voici ce à quoi pourraient ressemblé ses objectifs personnels[10] :
- Respecter les règles de l’école;
- étudier davantage;
- trouver de nouvelles stratégies d’apprentissage;
- renforcer sa confiance en soi;
- développer diverses compétences pour mieux vivre en société;
- entrer en relation avec les autres;
- mobiliser ses compétences;
- etc.
Conclusion
L'exigence minimum pour aller à l'université est d'obtenir ou l'équivalent du diplôme d’Etat, Soit 12 années de scolarité. Pas de raccourci possible! Les exigences d'admission varient également selon le programme d'études choisi, surtout lorsqu'il s'agit d'un programme circonscrit.
La fin des secondaires et les premiers pas à l’université sont souvent marqués par un petit choc émotionnel : quitter les secondaires, c’est bien souvent quitter un petit cocon relativement confortable, où les horaires sont bien fixés et où chaque individu est minutieusement suivi et évalué. A dieu les petites classes de vingt élèves et bonjour les grands auditoires surpeuplés (ou plus souvent sous-peuplés), les fêtes d’intégrations, les travaux pratiques et dirigés et les examens semestriels. Ce changement assez radical demande un temps d’adaptation : il s’agit de repenser sa méthode de travail, de réfléchir à ses ambitions et ses objectifs de façon à favoriser la réussite.
Joseph LUBUNGA
[1] https://www.cairn.info/apprendre-a-l-universite--9782804194178-page-97.htm [2] https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/r%C3%A9ussir/69035 [3] Loi-cadre de l’enseignement national-RDC n° 14/004 du 11 février 2014 [4]ENGUTA MWENZI, Jonathan. Le système éducatif de la République Démocratique du Congo et ses principaux défis. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 2020, no 85, p. 23-29. [5] https://journals.openedition.org/ries/9985 [6] ENGUTA MWENZI, Jonathan. Le système éducatif de la République Démocratique du Congo et ses principaux défis. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 2020, no 85, p. 23-29. [7] Idem. [8] ENGUTA MWENZI, Jonathan. Le système éducatif de la République Démocratique du Congo et ses principaux défis. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 2020, no 85, p. 23-29 [9] https://blog.siep.be/2017/03/les-facteurs-de-reussite-a-luniversite/ [10] https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/reussir-examens/trucs-et-astuces-revision-k1237







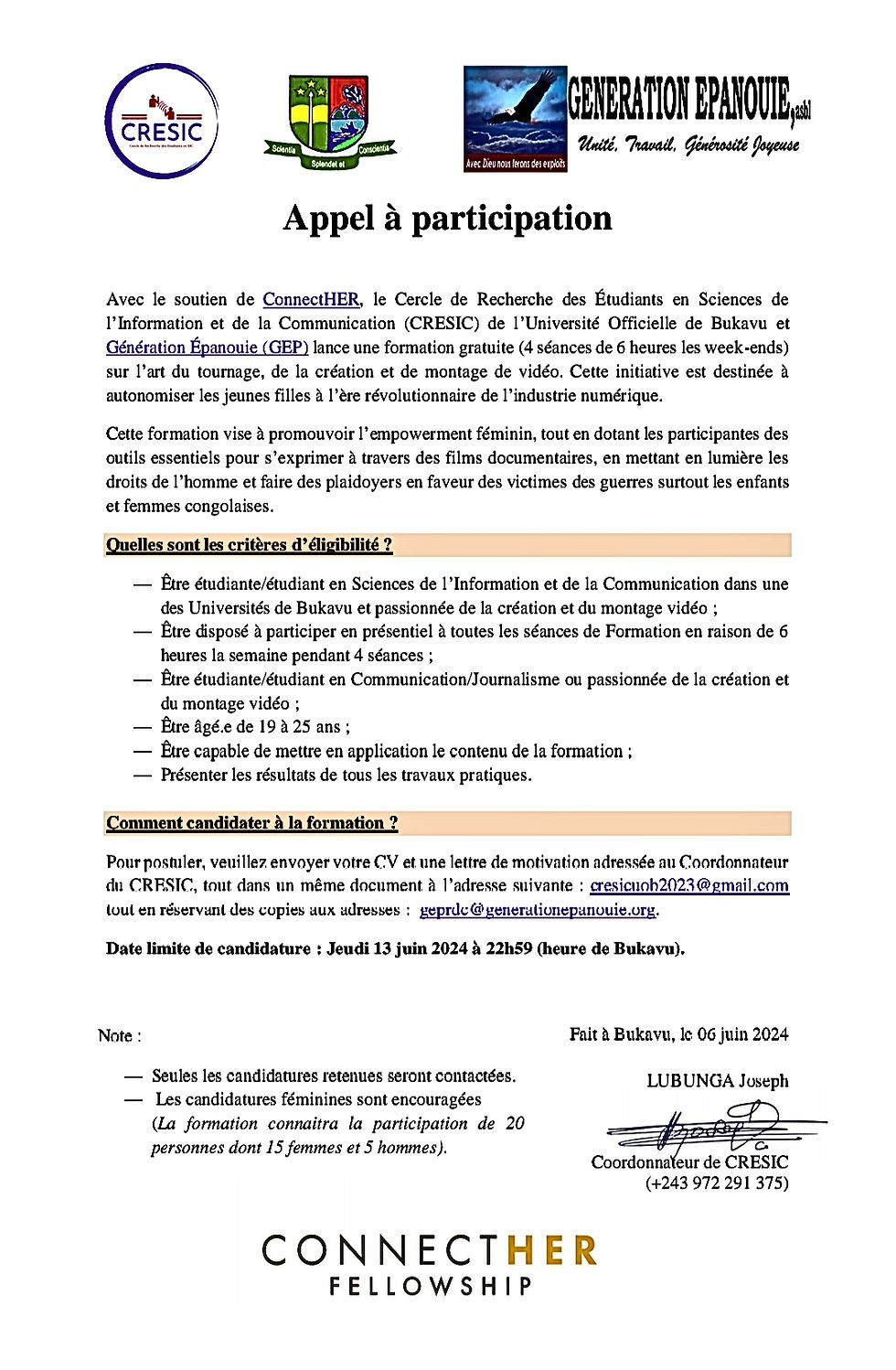


Commentaires